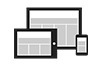L’hyper optimisation des technologies mène à l’efficience mais elle fragilise aussi les sociétés humaines. C’est le diagnostic du biologiste Olivier Hamant, chercheur à l’INRAE et à l’ENS Lyon. Directeur de l’institut Michel Serres, il vient de publier La troisième voie du vivant aux éditions Odile Jacob. Un ouvrage passionnant où il démontre que les mécanismes naturels multiplient les redondances, préférant la robustesse à l’efficacité immédiate, pour privilégier l’adaptabilité et favoriser la résilience. Il en tire des enseignements pour le fonctionnement des sociétés humaines. De quoi ouvrir le débat sur l’après Covid. Propos recueillis par Lionel Favrot
Qu’est-ce qui vous inspire chez Michel Serres ?
Olivier Hamant : J’aime bien dire de lui qu’il est un philosophe du terroir et des techniques. Sa philosophie propose de mobiliser les sciences pour habiter le monde. En 1994, il a publié le Contrat Naturel où il proposait d’étendre le contrat social aux non-humains pour assurer la viabilité de l’humanité sur Terre. Et en 2009, dans Le Temps des crises, il constatait la fin du néolithique et l’avènement de l’Anthropocène (1), en proposant de passer à une phase opérationnelle de ce contrat naturel.
Quel rôle veut jouer l’Institut qui porte son nom ?
Michel Serres l’a fondé en 2012 avec Ioan Negrutiu, professeur à l’ENS Lyon. Il s’agit d’un think tank qui rassemble un réseau de chercheurs de différentes disciplines pour anticiper la pénurie de ressources naturelles à venir.
C’est la “coviabilité socioécologique” que vous évoquez dans votre livre ?
Oui, c’est une notion développée par les juristes, en s’inspirant du contrat naturel de Michel Serres. On ne peut plus voir d’un côté l’Homme et, de l’autre, son environnement. On doit tenir compte de toutes leurs interdépendances. Ce travail est assuré par Olivier Barrière avec l’Institut Michel Serres dans un programme international de recherches interdisciplinaires, COVPATH, pour relier durablement l’humanité à la biosphère. La thèse de votre livre, c’est que l’Homme devrait s’inspirer de la nature car elle a développé des solutions souvent désordonnées mais résilientes. C’est votre intuition ou le résultat de vos recherches ?
Au départ, c’est une intuition. J’ai toujours été choqué par toutes ces pages de diagrammes des bouquins de biologie car le message subliminal consiste à laisser croire que le vivant serait très bien organisé. Quasiment comme une chaîne de montage. Pourtant, ces mêmes livres critiquent le créationnisme qui consiste à expliquer que Dieu serait à l’origine de toutes les espèces. Alors pourquoi présentent-ils le vivant de cette manière pyramidale ? Je vois bien l’intérêt de ces graphiques pour faciliter la compréhension de sujets complexes mais les mécanismes naturels n’ont rien à voir avec le taylorisme.
Vous en avez eu la confirmation par vos recherches de biologiste ?
Oui. Au départ, je me suis intéressé au rôle des forces mécaniques dans le développement des plantes. Après une thèse de biologie et une collaboration avec l’université de Berkeley aux États-Unis, j’ai pris la direction de l’Institut Michel Serres en 2021 et j’ai concentré mes recherches sur le rôle des hétérogénéités, des incohérences et des redondances dans la nature. Nos travaux confirment que cela ajoute de la robustesse.
Cette analyse divise-t-elle les biologistes ou s’est-elle imposée ?
À la fin du XXe siècle, la biologie moléculaire était dominée par une vision très centralisée du vivant autour d’un “gêne-maître”. Cette thèse a encore ses partisans mais il y a eu un tournant générationnel au début des années 2000. Plus on en sait, plus on se rend compte que ce n’est pas du tout ça. Le vivant est très aléatoire et très hétérogène.
Votre objectif avec ce livre, c’est de diffuser ce savoir au-delà du cercle scientifique ?
Oui. J’aime beaucoup la vulgarisation dans le bon sens du terme, c’est-à-dire la transmission des savoirs. Aujourd’hui, quand on parle écologie, on entend surtout les écologues parler biodiversité et les biologistes moléculaires restent au contraire cantonnés aux OGM, donc à la biotech. Mais ils peuvent avoir d’autres sujets d’intérêt et écrire une autre histoire avec le même savoir que les spécialistes de biotech.
Vous vous situez dans ce nouveau courant qui juge le développement durable parfois insuffisant et la décroissance trop radicale ?
Il y a des choses extraordinaires dans le développement durable mais certaines sont contre-productives. Quant à la décroissance extrême, elle ne mobilise pas du tout. Ma proposition, c’est de changer d’axe avec une troisième voie, entre la version béate du développement durable et la vision punitive.
Pour montrer les limites de l’efficacité technologique, vous faites référence à un certain nombre de concepts comme l’effet rebond et le paradoxe de Jevons. En résumé, vous alertez sur les effets pervers d’inventions au départ bénéfiques…
Le principe est assez simple : on a un gain en efficience énergétique au niveau de chaque unité de production mais au global, on se rend compte que la consommation augmente. L’exemple typique, ce sont les frigo. Si on multiplie dans chaque maison ces équipements en ajoutant caves à vin et air conditionné, même en améliorant leur efficacité individuelle, les besoins en électricité vont augmenter. S’enthousiasmer sur le gain d’efficience au niveau de chaque unité de production de froid, c’est trop simpliste.
On constate ce type d’effet dans d’autres cas ?
Oui. Le Paradoxe de Jevons, on l’a constaté avec le charbon, puis avec le pétrole. Plus on a une source efficace, plus on l’utilise. De même, moins les voitures consomment, plus on va faire de kilomètres. On le voit désormais avec le lithium des batteries. Les moteurs électriques ont un meilleur rendement que leur équivalent thermique mais leur développement va entraîner une forte hausse de la consommation d’électricité.
D’autant qu’on retrouve déjà ces batteries un peu partout : téléphone portable, vélo à assistance électrique… Cela va peser sur la ressource et sur la production d’électricité même si chaque nouvelle unité est à l’avenir plus efficiente que la génération précédente.
Dans certains cas, la mesure de la performance l’emporte même sur l’objectif initial…
C’est la loi de Goodhart, un économiste. Prenons le sport. La cible de départ, c’est se faire plaisir et rester en bonne santé. Mais on peut chercher à être performant au point de dériver dans le dopage et le sport business. Et au final abîmer sa santé. On peut aussi citer la production de chiffres dans la police si elle devient une fin en soi. Ou encore le facteur H des chercheurs qui vise à évaluer l’impact de leurs publications. Certains feraient n’importe quoi pour être publiés dans des revues de référence, quitte à frauder. Même si c’est encore marginal. On l’a vu pendant la période du Covid.
Selon vous, on croit régulièrement avoir trouvé une solution technologique miracle mais on sous-estime ces effets indirects. Et ça continue ?
Oui. Prenons une autre idée reçue : un pays doit attendre d’avoir satisfait les besoins élémentaires de sa population pour s’occuper d’écologie. Ensuite, son impact sur l’environnement va se déduire. C’est inspiré de la courbe dite de Kuznets, un économiste pour qui les inégalités sociales sont très fortes quand un pays se développe mais se réduisent par la suite mécaniquement.
C’est ce qu’on a l’impression d’observer en Europe…
La courbe de Kuznets est séduisante en théorie mais dans la pratique, c’est faux. Les pays les plus développés sont aujourd’hui les plus polluants. C’est au fond assez logique. Quand l’être humain a atteint un certain niveau de confort, il continue à réclamer de nouveaux services qui entraînent de nouveaux impacts. Il faut donc se préoccuper de coviabilité dans la phase même de développement d’un pays.
Quelle est la bonne méthode selon vous pour anticiper cette pénurie de ressources qui vous semble inévitable ?
Accepter la part d’aléatoire, ce qu’on appelle la stochasticité. Et face à cette part d’imprévisible, conserver une capacité d’adaptabilité. Face à une agression, on pourrait avoir tendance à ajouter des briques pour fortifier sa position alors qu’on doit toujours conserver un état dynamique de réparation. Notre meilleur bouclier par rapport aux fluctuations externes, ce sont nos propres fluctuations internes. C’est la loi d’Ashby : un système hétérogène sera plus souple et davantage capable d’autorégulation qu’un système rigide. On le voit bien dans la nature. Nos os sont plein de trabécules qui semblent partir dans tous les sens. En fait, ils s’adaptent et se réadaptent à nos prises de poids et aux sports qu’on pratique. C’est aussi la fable du chêne et du roseau, l’un peut rompre pendant que l’autre plie.
Vous parlez adaptabilité mais vous critiquez ceux qui veulent s’adapter au réchauffement climatique !
Adaptation et adaptabilité, c’est presque le même mot mais cela n’a rien à voir et cela ne demande pas les mêmes compétences. S’adapter, c’est croire qu’on sait prédire l’avenir. Exemple : annoncer un réchauffement de 2° et prendre des mesures précises en conséquence. Faire ce choix, c’est se préparer à de graves désillusions car il faut tenir compte des incertitudes. Conserver une capacité d’adaptabilité, c’est le principe du pont suspendu. Grâce à ses filaments en tension et ses colonnes en compression, il est autonome mécaniquement et capable de résister au vent. Il utilise aussi moins de matériaux pour sa construction.
Un exemple d’inefficacité de la nature qui, au final, se révèle être un atout ?
La photosynthèse est un super-exemple. Elle existe depuis 3,8 milliards d’années avec un rendement minable de 1 % et sans jamais avoir été optimisée. Du point de vue d’un être humain du XXIe siècle, cela paraît étonnant car, en cinquante ans, on a fortement augmenté les performances de nos panneaux solaires pour s’approcher des 20 %.
Pourquoi cette différence de performance ?
Parce que les plantes sont vertes, ce qui veut dire qu’elles renvoient la lumière verte, se privant donc d’une ressource précieuse. Au contraire, nos panneaux solaires sont noirs et captent toute la lumière. Là où les plantes ont un avantage, c’est que leur photosynthèse gère la fluctuation lumineuse et fonctionne même par très basse lumière, contrairement à nos panneaux solaires qui produisent de manière intermittente. Autre différence : un panneau solaire n’a aucune capacité de régénération alors que la plante peut avoir de nouvelles feuilles. Bref, en développant de nouvelles technologies, on ne devrait pas oublier cette adaptabilité nécessaire.
Et les OGM, c’est un progrès ou une mauvaise idée ?
Je renvoie dos à dos les deux camps, les pro et les anti-OGM. C’est un sujet clivant et il faut garder la tête froide. Là où je donne tort aux anti-OGM, c’est quand ils dénoncent la transformation du vivant. Depuis 10 000 ans, l’être humain n’a pas cessé de transformer les plantes. Les grosses tomates et les grosses aubergines qu’on mange aujourd’hui, même bio, ce sont des mutantes ! De plus, les craintes des anti-OGM révèlent une vision anthropo-centrée et même animalo-centrée. La biologie nous apprend que les plantes acceptent beaucoup mieux les transgênes que les animaux. Dans la nature, les gênes se baladent même énormément entre plantes. Autre exemple d’utilité des OGM : on obtient des gênes de croissance grâce à des levures qui les synthétisent. Qui voudraient encore prélever ces gênes de croissance sur des cadavres plutôt que d’en produire avec des OGM ? On se souvient que des enfants ont été contaminés dans les années 80 car les hypophyses de certains cadavres étaient infectées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et qu’ils en sont morts. Les pro-OGM ont raison pour moi sur un point : c’est une technologie parmi d’autres.
Du coup, sur quel point vous donnez raison aux anti-OGM ?
Les OGM ne sont pas une solution à l’alimentation mondiale, ou très partiellement. De plus, accepter que seulement cinq grands semenciers détiennent les graines indispensables aux agriculteurs dans le monde entier, c’est typiquement une optimisation qui fragilise le système. Le semencier fournit des graines hyper performantes en indiquant quand il faut les semer, comment il faut les traiter… Quand elles ont poussé, l’agriculteur n’a pas le droit d’en récupérer pour ses prochaines semences. Il doit racheter de nouvelles graines à son fournisseur. Au final, l’agriculteur perd le sens de son métier car on abolit toute prise de décision de sa part.
Quelle solution vous paraît plus robuste ?
Semer plusieurs variétés de graines pour résister à une maladie qui toucherait l’une d’entre elles et permettre à l’agriculteur de savoir ce qu’il plante. Laisser à seulement cinq grands semenciers, la maîtrise des graines qui nourrissent une grande partie de la population mondiale, c’est une hérésie.
À vous lire, la crise du Covid a démontré la fragilité de nos sociétés en apparence ultra-performantes !
Exactement. Si on a confiné la population, c’est que des années “d’optimisation” des hôpitaux les ont fragilisés au point de les rendre incapables de réagir face à une crise. Les services de pointe, centralisés dans les grandes villes, ont été débordés.
Vous voulez dire que la décentralisation favorise la réactivité face aux crises ?
La décentralisation et la technodiversité apportent de la robustesse ! On l’a vu lors de cette crise : la réponse sociale a été décentralisée. Chacun s’est pris en main et on a vu des tas d’initiatives. Les couturières qui fabriquaient des masques, j’ai trouvé ça super joyeux. Elles sont moins rapides que des industriels mais cette réponse est socialement plus robuste car ce savoir-faire peut être maîtrisé localement, en toute autonomie. On a vu aussi les collectivités locales se montrer plus réactives que des services centralisés.
Certains considèrent cette optimisation des hôpitaux parfaitement justifiée. Georges Képénékian, chirurgien et ancien maire de Lyon(2), défend toujours la suppression de ces petites maternités pour des raisons de sécurité…
C’est un “mindset”, une façon de penser assez typique du XXe siècle qui était clairement le siècle de la centralisation. Je ne dis pas qu’il faut un chirurgien de pointe tous les 10 km mais on peut avoir des petites maternités à condition que leur équipement et la formation de leur personnel soient pensés pour les rendre autonomes sans nécessairement avoir besoin d’atteindre une taille critique. Quand on observe le vivant, on voit qu’il sait très bien faire cela.
Mais si un accouchement devient difficile, la petite maternité n’aura pas le plateau technique correspondant !
Le problème, c’est que cette recherche compréhensible du risque zéro se fait au prix de fragiliser tout le système de santé. Des mères doivent parcourir des kilomètres pour rejoindre une maternité sophistiquée, ce qui leur fait aussi courir des risques. Des patients doivent attendre des mois pour des rendez-vous dans des services spécialisés concentrés dans des grandes villes, ce qui ne garantit pas une même qualité des soins pour tous.
Quand la pandémie a éclaté, le responsable d’une clinique privée interviewé dans Mag2Lyon, avait proposé que les HCL accueillent ses anesthésistes pour les mettre à niveau. Ils avaient fait les mêmes études au départ mais ils ne s’étaient pas tous spécialisés dans les maladies respiratoires. C’était une bonne idée ?
Une super idée ! Apprendre par ses pairs, de manière horizontale et décentralisée, c’est la solution la plus résiliente. On évite ainsi d’avoir d’un côté une équipe excellente mais débordée et de l’autre une équipe moins expérimentée qui se sent rejetée. On a deux équipes avec un spectre de compétences plus large, capables de répondre à des situations variées. Décentralisation et technodiversité là encore.
Que vous inspirent les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui pourrait provoquer des famines en Afrique dans les pays dépendant du blé ukrainien ? C’est l’effet papillon ?
C’est exactement cela. Et ce que je crains, c’est qu’on en déduise qu’il faut relancer l’agriculture hyper-industrielle car ce serait contre-productif vu qu’elle consomme énormément de pétrole. La solution, c’est une agroécologie décentralisée à fond avec des agriculteurs autonomes qui retrouvent le sens de leur métier. C’est clair.
Vous préférez une vision sociale à la vision libérale dans votre livre mais cela ne semble pas correspondre à un choix personnel du PS au lieu de LR. Expliquez-vous !
Non, cette opposition social/libéral ne croise pas les partis politiques. D’ailleurs, quand je rencontre des entrepreneurs, mon analyse sur l’adaptabilité leur parle ! Ils se rendent bien compte que le monde fluctue socialement et économiquement. Ils sont aussi conscients que c’est la robustesse des solutions plus que leur performance qui répondra à ces fluctuations. De plus, ils sont généralement actifs dans l’insertion sociale. Quand je fais référence à une vision sociale, je veux parler de la mobilisation du tissu social pour la santé des populations, l’éducation des enfants…
C’est plutôt l’individualiste que vous dénoncez. Mais en même temps, on constate souvent qu’un service partagé, ou les parties communes d’un immeuble, sont moins préservés qu’une propriété privée…
C’est l’analyse qu’a développée Garret Hardin en 1968 et qui a longtemps fait référence. Son analyse, c’est que si des éleveurs partagent un pré, chacun va agrandir son troupeau pour maximiser ses profits et qu’au final, cette ressource en herbe sera épuisée pour tous. Ce qu’on appelle la tragédie des communs. La solution, ce serait donc le chacun chez soi. Mais Elinor Ostrom, la première femme prix Nobel d’économie en 2009, a étudié les biens communs à travers le monde et elle a démontré l’inverse. Des biens communs ont été préservés pendant des centaines d’années dans certaines sociétés.
À quelle condition ce partage fonctionne ?
À condition de faire commun. Et le plus important, c’est le verbe faire. Si les gens ont des actions dans un loueur de voitures, ils prendront davantage soin de ces véhicules car ils se sentiront concernés. C’est aussi l’exemple de l’habitat participatif. Au départ, c’est plus long à monter et les appartements ne sont pas livrés clés à main. Mais on constate ensuite que leurs parties communes sont aussi bien entretenues que les appartements privés, et que cette préoccupation du bien commun déborde sur leur quartier. Leurs habitants établissent des relations nouvelles avec les voisins, montent des associations… Moins performants mais plus robustes !
Olivier Hamant : La troisième voie du vivant, 288p, 19,99 €
(1) Concept lancé en 2000 par l’américain Eugene F. Stoermer, biologiste et le néerlandais Paul Josef Crutzen, prix Nobel de chimie qui désigne l’époque où l’homme a atteint la capacité de transformer davantage la Terre que les éléments naturels. Il y a encore débat sur la date de départ : Révolution industrielle du XIXe siècle, maîtrise de la bombe nucléaire ou encore une date plus récente.
(2) Auteur d’Hippocrate et les territoires, édition de l’Aube : émission Lyon Politiques du 21 octobre 2021, sur BFM Lyon en partenariat avec Mag2Lyon
Entretien publié dans le Mag2Lyon N°144